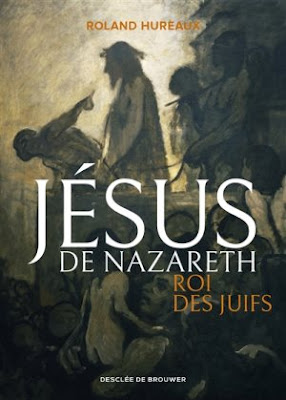Peut-on
disserter sur l’Église en ignorant le Christ ?
Jean
Duchesne – publié sur Aleteia le 10/11/21
Tous
les mardis, Jean Duchesne décode les grands événements du monde et de l’Église.
Tandis que les projets de réforme au sein de l’Église de France suscitent de
nombreux commentaires, il s’interroge : parler de l’Église en mettant
prudemment Dieu entre parenthèses, n’est-ce pas dissimuler une part décisive de
la vérité ? L’avenir du christianisme ne dépend pas uniquement de son image
médiatique.
Par
les temps qui courent, on disserte d’abondance sur l’Église, pour expliquer
qu’elle va mal et prédire son naufrage dans une marginalité insignifiante. Les
abus sexuels commis par des prêtres sont déclarés massifs et « systémiques »,
ce qui permet de dénoncer ouvertement le cléricalisme et indirectement la
structure épiscopale et en fait apostolique de l’institution, donc la source
même de son existence. Certains experts ne lui voient de chances de survie que
dans une « synodalité » conçue comme un système de démocratie directe
en régime d’assemblée, où la parole qui s’impose exerce un pouvoir absolu.
Qu’il
soit cependant non moins permis de se demander s’il est adéquat de poser le
problème en termes politiques de pouvoir. L’Église n’est pas une société ou
institution ordinaire, comme peut l’être une nation, un parti de gouvernement
ou d’opposition, une entreprise, un syndicat ou même une association à but non
lucratif. Elle n’a pas sa propre fin en elle-même. Comme servante qui en a reçu
la mission, elle ne fait que relayer l’offre de Dieu : le reconnaître comme
Père, devenir ses enfants et avoir part à sa vie, laquelle consiste non pas à
prendre, mais au contraire à donner et même à se donner inconditionnellement —
à vue humaine au risque de se perdre —, mais dans la pleine liberté de l’être.
Une
institution purement humaine ?
La
puissance paradoxale qui se révèle et se livre ainsi ne peut pas être
dominatrice. Elle est, à l’inverse, libératrice. Et, puisqu’il faut la
transmettre pour la recevoir soi-même, la proposer requiert qu’elle soit non
seulement annoncée, mais encore confirmée concrètement par le comportement de
ses hérauts et témoins, qui sont la partie visible de ce qu’on appelle
l’Église. Bien sûr, son message peut constamment être faussé et dénaturé, car
la liberté qu’il confère reste soumise à toutes sortes de tentations
d’appropriation et de pouvoir sur les autres. Les abus plus ou moins flagrants
de quelques-uns de ses membres peuvent sensiblement éroder son audience en
scandalisant, c’est-à-dire en faisant trébucher dans la foi. Mais ces
détournements ne suffiront jamais à décourager Dieu d’offrir part à sa vie.
Que
des observateurs extérieurs s’intéressent uniquement à ce que peuvent traiter
leurs outils d’analyse, c’est compréhensible. Ce qui l’est moins, c’est que, de
l’intérieur, des baptisés se proclamant tels (voire des prêtres !) se
contentent des mêmes critères pour évaluer les chances de survie du
christianisme, comme si son avenir dépendait exclusivement de son image
médiatique ou de son inculturation. C’est là faire de l’Église une institution
purement humaine et sans raison d’être autre qu’accidentelle. Si son but n’est
que d’exercer sinon du pouvoir, au moins quelque influence, ou simplement d’en
garder, ses membres ne comptent plus (bien présomptueusement) que sur leurs
propres vertus. Et s’ils veulent seulement se faire accepter, ils se soumettent
passivement par avance aux normes sociales du moment.
Quand
le péché aggrave le crime
Parler
de l’Église en mettant prudemment Dieu entre parenthèses, sous prétexte que son
existence n’est pas évidente pour tout le monde, c’est donc, d’une certaine
façon, dissimuler la part décisive de la vérité. C’est un peu comme si on
dissertait sur le football en ignorant délibérément qu’il s’agit d’un jeu de
ballon avec des règles et en réduisant le phénomène à son impact
socio-économique. Qu’on n’aille pas s’imaginer que « théologiser » les
réactions aux abus commis par des clercs revient à relativiser ces crimes. La
référence à ce qu’ils trahissent, les fait au contraire ressortir comme des
abominations où, à la faute gravissime que réprouvent les lois de la morale «
naturelle » et que sanctionne la justice humaine, s’ajoute le péché caractérisé
de se servir de Dieu au lieu de le servir en servant son prochain.
Allons
plus loin et soyons plus précis en nous demandant quel rapport tout cela peut
avoir avec le Christ — celui qui nous montre le Père (Jn 14, 7-9). Il a dit : «
Ce que vous avez fait (par des égoïsmes et aveuglements en tout genre) ou pas
fait (par manque de compassion) à ces petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait ou pas fait » (Mt 25, 40 et 45). C’est pourquoi, en tant
que « membres du Corps du Christ, chacun pour sa part » (Rm 12, 5), tous les
chrétiens sont — ou devraient se sentir —, même s’ils n’ont commis aucune
abomination et n’ont pas d’indifférence à se reprocher, personnellement blessés
en découvrant les ignominies perpétrées par inversion de la mission reçue en
jouissance cynique.
Sans
le Christ, que reste-t-il de l’Église ?
Ce
qui reste alors à faire n’est pas de se substituer aux successeurs des apôtres
auxquels il revient de prendre les mesures propres à prévenir et réparer le mal
autant qu’il est possible. Il ne peut être non plus question de faire profil
bas en attendant d’hypothétiques jours meilleurs, et encore moins de désespérer
en se résignant à une marginalité présumée irréversible. Mais c’est du Christ
qu’il faut encore et toujours se rapprocher, lui qui est « en agonie jusqu’à la
fin des temps », comme l’a écrit Blaise Pascal, et pourtant déjà ressuscité. En
un mot, le christianisme ne survit pas sans le Christ, et l’avenir de l’Église
qui est son Corps (Éph 1, 22-23) ne passe vraisemblablement pas par la mise en
œuvre des recommandations des uns ou des autres, mais par une perception sans
cesse à renouveler des véritables enjeux.
Ce
recentrage perpétuel s’opère pour les croyants dans la fréquentation de la
Parole de Dieu et des sacrements, dans la prière quotidienne et dans l’exercice
assidu de la charité. Mais les autres ont aussi intérêt, qu’ils veuillent
plutôt du bien ou plutôt du mal à l’Église, à se renseigner sur le Christ pour
ne pas s’embourber dans des épiphénomènes. À tous ceux qui se soucient un peu
de ce qu’est au fond la réalité de l’institution sur laquelle on disserte à
l’envi dans l’actualité, on peut ainsi conseiller le Jésus de Nazareth, roi
des Juifs de Roland Hureaux, paru cet automne chez Desclée De Brouwer.
Tout
ce qu’il vaut mieux savoir sur Jésus
L’auteur,
normalien, historien et énarque, passe systématiquement en revue toutes les
sources sur ce qui est su du Christ — dans le christianisme, bien sûr, mais
aussi grâce aux documents juifs et païens. La lecture transversale des
évangiles permet de cerner la personnalité de Jésus telle qu’elle a été perçue
par ses contemporains et de synthétiser les contenus de sa prédication. Le défi
des miracles qui heurtent la rationalité contemporaine n’est pas esquivé, de
même que sont affrontées les questions des discordances entre les témoignages,
des relations de Jésus avec les femmes et avec les pharisiens, ainsi que de
l’organisation qu’il donne à la troupe de ses disciples. L’étude des vives
tensions au sein du milieu permet d’identifier les mécanismes qui aboutissent à
l’exécution du « roi des Juifs ».
Tout
cela sans parti-pris apologétique (y compris à propos des récits du matin de
Pâques), et simplement en présentant de façon ordonnée toutes les informations
disponibles. Sans doute existe-t-il, sur tous les médias possibles, quantité
d’autres ensembles accessibles de données au sujet de Jésus. Mais cette
somme-là a le mérite de fournir, sans qu’il soit besoin d’un acte de foi et
d’allégeance, tout ce qu’il vaut mieux savoir du Christ quand on parle de
l’Église qui n’existe que par lui et que nul ne peut ni s’approprier ni
supprimer.
Jésus
de Nazareth, roi des Juifs,
par Roland Hureaux, Desclée de Brouwer, septembre 2021.